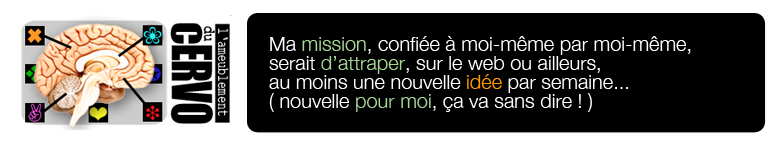Pourquoi cette asymétrie ? Pourquoi cette déplorable et cruelle réticence à méditer la défaite du communisme? Peut-on tout à la fois se prétendre antitotalitaire, comme s’en flatte notre époque, et rechigner non seulement à penser le communisme réel mais à le condamner avec la même énergie que le nazisme ? (2)A cette question, Béatrice Levet apporte plusieurs réponses, mais elle en développe une en particulier qui met en jeu la quatrième blessure narcissique infligée à l'Humanité. Là, le lecteur attentif aura compris que le genre humain a donc déjà subi auparavant 3 blessures narcissiques... Et il se sera peut-être demandé : lesquelles ? Eh bien sache, impatient lecteur, que c'est Sigmund Freud qui a pointé les 3 premières dans son Introduction à la psychanalyse.
La science, expliquait-t-il, a déjà infligé à l'Humanité deux blessures narcissiques. La première remonte au XVIème siècle, lorsque Copernic (entre autres) a mis fin à la vieille conception géocentrique de l'Univers, lequel décidement, ne tournait pas autour de notre petit personne... La seconde, 3 siècles plus tard, est l'œuvre de Charles Darwin qui a montré que l'espèce humaine n'avait aucune raison de revendiquer une place particulière dans le règne animal ou dans l'arbre du vivant. Et la troisième ? Eh bien la troisième, Sigmund y travaille activement au moment même où il écrit ces lignes...
Un troisième démenti sera infligé à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique de nos jours qui se propose de montrer au moi qu’il n’est seulement pas maître dans sa propre maison, qu’il en est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe, en dehors de sa conscience, dans sa vie psychique. (3)Fin du flash-back. Selon Béatrice Levet, la quatrième blessure narcissique nous est infligée par l'effondrement de l'utopie communiste, utopie qui - on le sent bien - est la mère de toutes les utopies politiques globales et les entraîne avec elle dans sa chute. L'idée qu'on puisse mettre à bas l'ancien monde et en reconstruire un nouveau, radicalement neuf, entièrement basé sur la Raison, et fondamentalement meilleur, cette idée a vécu. Bref, c'en est fini de la conception prométhéenne ou messianique qui fait de l’homme le bâtisseur du royaume du Bien. C’est en ce sens que l’on peut dire avec Georges Steiner que « la défaite du communisme est une grande défaite de l’humanité. » Ou alors avec François Furet : Nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. (4)
Sale histoire pour les utopistes, radicaux et autres adeptes d'un ordre nouveau... Sans être tout à fait sûr d'adhérer de bonne grâce à cette vision un peu désenchantée, je dois bien reconnaître que les transformateurs en bloc du genre humain n'ont pas amené à des périodes de l'histoire très riantes, tandis que les améliorateurs à la petite semaine et autres réformistes ont remporté quelques succès et rendu le monde (localement) un peu plus vivable...
Mais attention ! La chute de l'utopie communiste constitue-t-elle vraiment LA quatrième blessure narcissique ? Car Béatrice Levet n'a pas l'exclusivité, bien au contraire ! Il existe même des dizaines de candidats à ce titre envié... Ici, c'est le marché, là le système nerveux (?) Pour certains, c'est la mondialisation, pour d'autres c'est Internet (ça mange pas de pain et ça fait moderne... encore pour une ou deux décennies !)... Plus orientée philosophie, cette bonne vieille mort de Dieu pourrait tout aussi bien faire l'affaire ! A moins qu'on lui préfère, pour rester dans le champ des sciences et techniques, la dissolution des frontières entre l'Homme et la machine, qui me semble un candidat assez plausible...
Bref, côté blessures, il n'y a que l'embarras du choix, et ce n'est sans doute pas fini ! Allez, dépêchons-nous d'en choisir une quatrième, qu'on puisse commencer à rechercher activement la n°5...
(1) Nicolas Werth - L’ivrogne et la marchande de fleurs. Autopsie d’un meurtre de masse, 1937-1938
(2) Bérénice Levet - La grande nuit stalinienne - Causeur.fr
(3) Sigmund Freud - Introduction à la psychanalyse
(4) François Furet - Le passé d'une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle